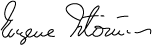Dans le magazine Time du 2 décembre 1957 on pouvait lire cette chronique pleine d’humour : « Pendant quelques années, le pianiste américain qui voyageait le plus était un personnage insaisissable nommé Leogene Graffteiner. Sous plusieurs identités différentes il jouait la semaine dernière Brahms à Boston, Schumann à Cincinnati et Mozart à Hambourg. Partout il a été acclamé par les critiques. Leogene Graffteiner est en réalité quatre pianistes : Gary Graffman, Leon Fleisher, Eugene Istomin et Jacob Lateiner. Les trois premiers sont des amis proches, et tous partagent une admiration extravagante pour un Steinway de concert ancien connu sous le nom de « Vieux 199 ». C’est pourquoi ils se le passent les uns les autres quand ils donnent des concerts aux Etats-Unis. Graffman et ses associés sont aujourd’hui les leaders d’un groupe de jeunes pianistes américains qui ont franchi le périlleux fossé entre un jeune prodige et un artiste de métier. »
De fait, ces quatre pianistes sont le fer de lance du petit groupe que la presse a eu l’idée d’appeler, avec leur approbation, les Outstanding Young American Pianists ! Les OYAPs, pour faire court. En français, les Jeunes pianistes américains de haut niveau. Une association dont il n’existe pas d’équivalent dans le monde, et dont la référence pourrait être schumannienne, les Compagnons de David.
L’objectif de cette association informelle semble être de s’entraider pour se faire une place dans un monde musical parfois hostile, mais en fait cela va bien au-delà. Dans une interview de 1953, reprise dans le livret de la réédition complète de ses enregistrements RCA, William Kapell évoque l’idéal de fraternité qui unit ses membres : « Il y a un groupe de jeunes musiciens qui ont des liens très étroits les uns avec les autres, des liens à la fois spirituels, musicaux, idéologiques. Nous partageons plus ou moins les mêmes philosophies fondamentales. Bien sûr, il y a des personnalités différentes, des manières différentes d’aborder notre art, mais nous avons tous une chose en commun : nous communiquons les uns avec les autres. Nous nous confions les uns aux autres, et nous faisons tout notre possible pour faire partager ces émotions et ces sentiments avec le public ».
Cinquante années plus tard, Istomin rappelait dans ses Grandes Conversations : « A l’époque, il était inconcevable pour les critiques américains, et pour les autres aussi d’ailleurs, que des pianistes américains puissent avoir le raffinement et la profondeur musicale des pianistes européens, leur patine, leur aura. La technique, oui ! Mais pas la musicalité. » Il était malaisé de lutter contre les préjugés de la presse et du public. Les deux plus courants étaient d’une part que les jeunes pianistes manquaient de maturité et jouaient forcément de façon superficielle et, d’autre part, qu’il est impossible qu’un même interprète puisse rendre justice à la fois à Beethoven et à Chopin… Lors de ses premiers concerts en Europe, Istomin constata que la situation n’était pas beaucoup plus favorable. A Lyon, en mai 1950, un critique l’avait traité de « pianiste typiquement américain, avec des doigts d’acier et un toucher dactylographique, sans aucune sensibilité musicale ». Il avait même ajouté : « Mais où donc a-t-il trouvé cette invraisemblable cadence ? Il y a des limites au mauvais goût ! » Or Istomin avait joué la cadence de Beethoven… En Suisse, les préjugés des critiques américains semblaient avoir déteint sur leurs collègues suisses. Lors d’un même récital, l’un avait trouvé son Bach et son Mozart remarquables, mais était resté sur sa faim pour Chopin et Ravel. L’autre avait pensé exactement le contraire.
Un autre combat des OYAPs était dirigé contre les organisateurs stupides et les imprésarios grippe-sou. A la fin des années 40 et jusque dans les années 60, il y avait aux Etats Unis des centaines d’associations qui accueillaient des Community Concerts, jusque dans les plus petites villes. Chacun des OYAPs a donné plusieurs centaines de récitals pour cette organisation. Les cachets étaient modestes mais ils le faisaient avec plaisir car c’était bien dans leur philosophie de ne pas partager la musique seulement avec le public des grandes cités. Là où la situation se gâtait, c’était au niveau des programmes. Ward French, le directeur, exigeait des œuvres accessibles, célèbres si possible, en tout cas brèves. Si une partition lui semblait trop longue, il n’hésitait pas à demander à l’artiste de la couper. Tous les OYAPs ne manquaient pas de protester et d’essayer de sauvegarder des programmes cohérents et aussi ambitieux que possible. William Kapell avait même tenté de jouer la Sonate de Copland ! Graffman, qui avait dû renoncer à la Wanderer Fantaisie de Schubert, parce que trop longue, évoqua les mésaventures d’Istomin avec le Carnaval de Schumann : « Courageusement, Eugene avait eu l’audace de le programmer et, quand on lui demanda de faire des coupures, il réagit comme si un Aztèque le menaçait de lui arracher ses organes vitaux. Il joua vite, mais conserva toutes les notes et toutes les répétitions, en dépit du conseil paternel donné par Montezuma French : ‘Fais attention, Istomin, si vous vous payez notre tête, nous nous paierons la vôtre’. Et de fait, il prit sa revanche en ne l’engageant quasiment plus pour des Community Concerts. »
La cupidité et la mesquinerie des agents avait sa grande prêtresse : Ruth O’Neill. Gary Graffman en livre un portrait savoureux dans son autobiographie I Really Should Be Practicing : « Elle était « le bras droit de Judson et la trésorière de Columbia Artists. Elle ne manquait jamais d’accompagner le chèque d’une petite leçon sur les vertus de la frugalité… elle était vraiment contrariée si elle nous surprenait à dépenser notre argent de façon frivole, par exemple en allant au cinéma… Le critique Cecil Smith écrivit un jour qu’ ‘elle avait une caisse enregistreuse en guise de cerveau’. Willy Kapell aimait dire que ‘les pièces de monnaie jaillissaient de ses yeux comme d’une machine à sous’. » Quand les jeunes pianistes essayaient de lui suggérer « qu’ils méritaient désormais un cachet un peu plus élevé. Elle faisait la moue, regardait le quémandeur comme une maîtresse d’école, et répondait avec la voix la plus doucereuse : ‘Mon cher, quel âge avez-vous ? Pourquoi voulez-vous brusquer les choses ? Vous avez bien le temps.’ Le scénario se reproduisit pendant un paquet d’années. ‘Quel âge avez-vous?’ devint un cri de guerre des OYAPs. » Graffman raconte qu’au bout de huit années Istomin avait imaginé « arriver dans le repaire de la trésorière en se trainant, chauve et portant une barbe grise, pour poser la question rituelle. La vieille bique aurait chevroté : ‘Eugene, quel âge avez-vous?’ Et Eugene aurait répondu d’une voix essoufflée : ‘Quatre-vingt-treize ans’. C’en était trop pour lui, et il s’en était allé chez Hurok. »
Une autre résolution des OYAPs était de s’entraider et de s’organiser pour pouvoir donner leurs concerts sur les meilleurs pianos possibles. Alexander Greiner, le directeur du département « pianos de concert » de Steinway, avait demandé à son chef technicien, Bill Hupfer, d’initier les OYAPs aux arcanes de la facture de piano. Il leur expliqua les réglages les plus subtiles en matière d’accord, d’harmonisation, d’égalisation, de telle sorte qu’ils puissent demander aux techniciens locaux les ajustements nécessaires. Cela pouvait être précieux dans certains cas, mais les OYAPs comprirent vite que lorsqu’un accordeur n’est pas compétent, il vaut mieux ne rien lui demander car une intervention mal maîtrisée pouvait rendre l’instrument encore plus catastrophique… Or, dès que l’on s’éloignait de New York les bons pianos devenaient rares, et les bons accordeurs encore davantage. Le plus sûr était donc de faire expédier de New York un instrument parfaitement réglé.
Le CD 199 (son numéro chez Steinway) fut le piano préféré des OYAPs pendant au moins une dizaine d’années. Gary Graffman lui était particulièrement attaché : « J’avais l’impression de jouer d’un instrument à cordes – comme s’il était possible de faire un crescendo sur une seule note. Quand j’étais assis à son clavier, j’étais en mesure de m’immerger complètement dans la musique. » Il ajoute qu’une des grandes raisons pour laquelle ce piano était très apprécié, c’était son « incroyable versatilité. Dans sa grande époque, il pouvait rugir avec moi dans un concerto de Tchaïkovsky et se faire entendre dans les grands espaces du Pré aux moutons de Central Park puis, avec la même aisance, sous les doigts de Eugene, se mêler aux délicates sonorités d’Isaac Stern et Leonard Rose dans un concert de trio, ou, avec Claude Frank à son clavier (en ivoire), illuminer le cycle complet des Sonates de Beethoven à Hunter College… Notre commune dépendance à ce piano atteignit de telles proportions que pour deux ou trois saisons, quatre d’entre nous (Leon, Eugene, Jacob et moi-même) ont réuni leurs forces et trouvé une façon d’avoir le CD 199 envoyé aux quatre coins du pays ». Un calendrier était établi. Lorsque plusieurs pianistes souhaitaient disposer du CD 199 le même jour, un ordre de priorité était établi en toute collégialité, tenant compte de l’importance des concerts et de la qualité du piano disponible dans les salles concernées. Il n’y eut jamais de conflit, ni dans la répartition des dates, ni dans le partage des frais.
L’amitié, le partage et une saine émulation étaient les moteurs du groupe, ainsi qu’en témoigne Fleisher dans My Nine Lives : « Nous jouions constamment les uns pour les autres. Nous allions et venions entre les maisons des uns et des autres, testant de nouveaux répertoires, écoutant, jouant, bavardant. Nous avions pris nos habitudes dans le sous-sol de Steinway, là où étaient entreposés les pianos de concert… Nous réservions chacun des créneaux de deux heures pour travailler. Je prenais deux heures, puis Gary, puis Eugene, puis Jake (Lateiner) ou Claude (Frank). Si nous planifions correctement, nous pouvions l’occuper toute la nuit ! Quand nous ne travaillions pas, nous allions au concert, nous avions juste à traverser la rue pour être à Carnegie Hall. Ensuite nous allions à Carnegie Deli pour manger des sandwiches au pastrami et nous débriefions ce que nous avions entendu. Nous avions une camaraderie remarquable. Si nous étions en concurrence, c’était une concurrence saine. Chacun de nous avait sa propre approche de l’instrument et faire de la musique entre nous était la façon dont nous débattions ». La bonne humeur régnait. Gray Graffman déclara au magazine Time : « Quand un de nous trois joue bien, on n’entend rien dans le sous-sol de Steinway, mais quand il y en a un qui joue mal, on entend de grands cris et des protestations : ‘Espèce de cochon, quand vas-tu te décider à travailler ?’».
Qui étaient les OYAPs? Outre Istomin, Kapell, Fleisher, Graffman, qui étaient les piliers du groupe, il y avait notamment Jacob Lateiner, Claude Frank, Lillian Kallir, Seymour Lipkin. Nul doute que si Katchen, qui se plaignait de la manie américaine de l’esprit de compétition n’était pas parti si tôt en France, il se serait joint à eux. L’esprit d’exclusion était étranger à la philosophie des OYAPs. Van Cliburn, Rosen ou Janis n’en faisaient pas partie, mais ils n’étaient certes pas considérés comme des étrangers. D’autres pianistes, nés quelques années plus tard, comme John Browning, André Watts, James Tocco ou Joseph Kalichstein, eurent des relations privilégiées avec les pionniers. Le dernier qui put se réclamer de cette lignée fut Emanuel Ax, qui fut adoubé par Eugene istomin après son succès au Concours Rubinstein.
Dans les premières années, c’était William Kapell qui prenait le plus souvent l’initiative pour défendre ses collègues. C’est ainsi qu’il obtint pour Leon Fleisher, aussitôt après son triomphe au Concours Reine Elisabeth, un contrat chez Judson qui, auparavant, ne voulait pas entendre parler de lui. Par la suite, Eugene Istomin prit le relais : il apportait une oreille sans concession pour le jeu de ses collègues, recherchait des engagements pour ceux qui en manquaient, les mettait en contact avec les grands musiciens dont il était proche (Casals, Horowitz…). Lorsqu’en 1958 Steinway, accusé par certaines associations d’encourager le massacre des éléphants pour se procurer l’ivoire de ses claviers, décida de le remplacer par une matière synthétique, Istomin mobilisa les OYAPs pour défendre, en vain, l’exception des pianos de concert. Il se consacra à ces luttes tant que son poids dans le monde musical américain lui permit d’être un soutien efficace.
Aujourd’hui, le mot OYAP reste en usage aux Etats-Unis pour désigner un jeune pianiste très prometteur, mais il est douteux qu’un jour puisse renaître l’idéal musical et humain qui animait la première génération.
Les OYAPsivan2020-02-21T23:50:22+01:00