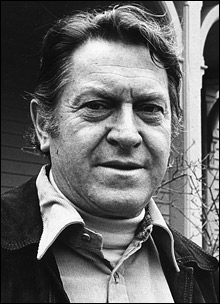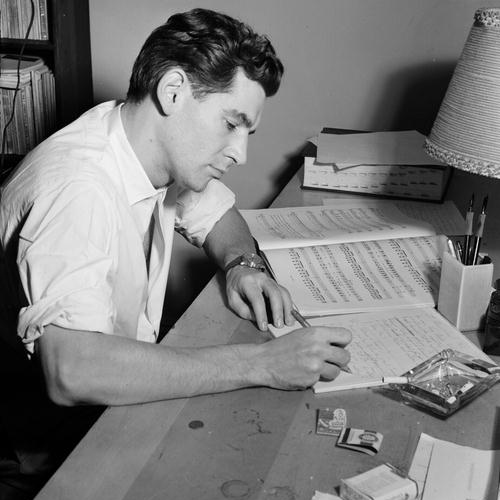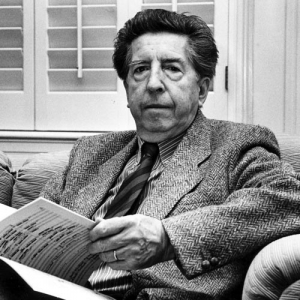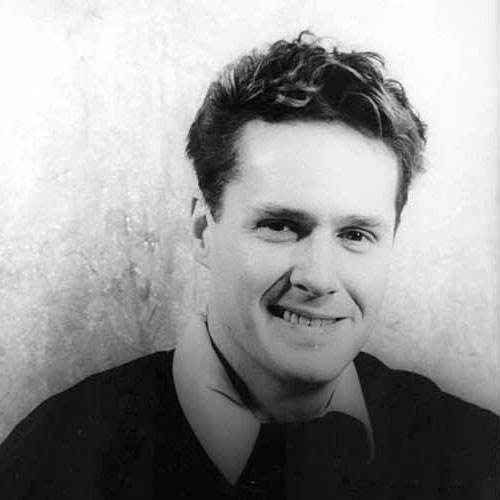Lorsque son calendrier le lui permettait, il assistait volontiers aux créations, surtout lorsqu’il s’agissait de compositeurs qu’il connaissait bien, ou lorsque sa curiosité avait été éveillée par la presse ou par des amis. Ainsi, il s’était enthousiasmé pour Mass de Bernstein, qui avait été très mal accueilli lors de sa création. Il prit sa défense dans une interview donné à John Gruen pour le New York Times en 1971 : « Je pense que c’est le grand œuvre de Bernstein. Pour moi, tout sonne juste! Vous avez son âme et ses convictions, et tout son fantastique talent présenté sur un plat d’argent. Oui, c’est « populaire ». Non, ce n’est pas hétéroclite. C’est du pur Bernstein. Si vous l’aimez, vous aimerez l’œuvre. C’est ce que je fais. Dans mon univers, il y a de la place pour Stravinsky, Nono et Bernstein. Je suis fatigué de voir un des plus grands talents du siècle se faire éreinter et calomnier. Profitons plutôt de lui tant qu’il est là !»
Istomin avait à cœur, chaque fois qu’il effectuait une tournée officielle à l’étranger (que ce soit au Japon, en Iran ou en Bulgarie), de toujours jouer quelques pièces de compositeurs américains contemporains. Des Préludes de Chasins, les Anniversaries de Bernstein, la Burlesque de Ned Rorem… Lorsqu’il prit la direction du Concours William Kapell, il y défendit la place de la musique contemporaine, commandant une œuvre imposée successivement à George Perle, Ned Rorem et Henri Dutilleux.
Il eut également des collaborations importantes avec plusieurs compositeurs. Le premier fut Harold Brown, un disciple de Nadia Boulanger. Brown lui fit découvrir d’autres répertoires, comme la musique vocale de la Renaissance et du Baroque naissant. Istomin joua les Preludes de Brown lors de son premier récital à New York et les rejoua de temps à autre.
Ned Rorem fut son ami pendant plus de soixante années. Il joua quelques pièces pour piano et il admirait beaucoup les mélodies, au point d’enregistrer avec Donald Gramm deux cycles sur des poèmes de Walt Whitman. (lien)
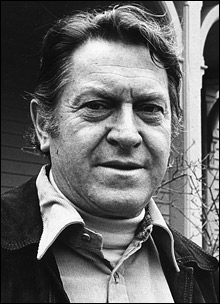
Leon Kirchner
Les deux années passées près d’Adolf Busch l’incitèrent à jouer plusieurs de ses œuvres : sa Suite pour piano qu’il programma notamment lors de son récital à Carnegie Hall en décembre 1946, les Seven Spirituals pour orchestre de chambre avec piano qu’il joua sous sa direction (il existe un enregistrement), et la Sonatine pour violon et piano op. 64 dont il donna la première audition en privé.
En 1956, Istomin avait prévu d’assurer la création du Concerto pour piano de Roger Sessions, une commande de la Juilliard School pour célébrer son 50ème anniversaire, mais la complexité de l’œuvre et son calendrier très chargé l’obligèrent à renoncer et c’est Beveridge Webster qui s’en chargea. Quelques années plus tard, Istomin commanda à Sessions sa Troisième Sonate pour piano, une œuvre qui lui est dédiée mais qu’il ne joua pas non plus en concert. C’est son ami Jacob Lateiner qui en assura la création.
Autre dédicace importante, celle du troisième prélude de Dutilleux, Le Jeu des contraires, qu’Istomin commanda pour le Concours William Kapell, et qu’il interpréta en public quelques années plus tard.
Finalement, son engagement le plus notoire comme interprète fut le 1er Concerto pour piano de Leon Kirchner, composé en 1953. Il l’aimait beaucoup et le mit à son répertoire en 1958, le jouant avec plusieurs orchestres américains pendant les deux années suivantes, notamment avec le San Francisco Symphony sous la direction du compositeur, en décembre 1960. Puis il cessa de le jouer, faute de demande des orchestres.
Lorsqu’il recevait des partitions, il trouvait toujours le temps de les regarder et de les déchiffrer, mais il n’en mit que très peu à son répertoire. Il était très embarrassé de ne jamais avoir joué les œuvres de son ami George Perle. Il avait travaillé la 2ème Sonate d’un autre grand ami, Alberto Ginastera. Il l’avait même jouée au compositeur, qui s’en montra très satisfait, mais il renonça à la donner en public. Il appelait Ginastera le « Prokofiev argentin », ce qui signifiait que c’était pour lui un piano trop percussif et que cela ne pouvait le satisfaire.
Il avait prévu que lorsqu’il se retirerait, il prendrait enfin le temps d’écouter, de découvrir, d’étudier les œuvres de compositeurs contemporains, ce qu’il n’avait jamais eu le temps ni la disponibilité mentale de faire au long de sa carrière. Pour cela, il avait mis de côté des partitions et des enregistrements (du Moïse et Aaron de Schoenberg aux Etudes de Ligeti). La maladie lui laissa peu de temps pour satisfaire sa curiosité.

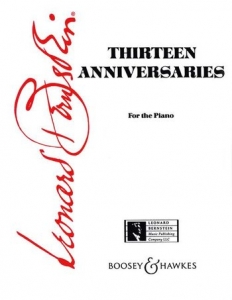 Aujourd’hui, disait-il, les gens ont le choix entre Madonna et Boulez. Il n’y a rien entre les deux ! Mozart, aimait-il à rappeler, trouvait le moyen dans une même œuvre de satisfaire le public, son dédicataire, lui-même, son père, ou même l’empereur…
Aujourd’hui, disait-il, les gens ont le choix entre Madonna et Boulez. Il n’y a rien entre les deux ! Mozart, aimait-il à rappeler, trouvait le moyen dans une même œuvre de satisfaire le public, son dédicataire, lui-même, son père, ou même l’empereur…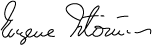
 Lorsque son calendrier le lui permettait, il assistait volontiers aux créations, surtout lorsqu’il s’agissait de compositeurs qu’il connaissait bien, ou lorsque sa curiosité avait été éveillée par la presse ou par des amis. Ainsi, il s’était enthousiasmé pour Mass de Bernstein, qui avait été très mal accueilli lors de sa création. Il prit sa défense dans une interview donné à John Gruen pour le New York Times en 1971 : « Je pense que c’est le grand œuvre de Bernstein. Pour moi, tout sonne juste! Vous avez son âme et ses convictions, et tout son fantastique talent présenté sur un plat d’argent. Oui, c’est « populaire ». Non, ce n’est pas hétéroclite. C’est du pur Bernstein. Si vous l’aimez, vous aimerez l’œuvre. C’est ce que je fais. Dans mon univers, il y a de la place pour Stravinsky, Nono et Bernstein. Je suis fatigué de voir un des plus grands talents du siècle se faire éreinter et calomnier. Profitons plutôt de lui tant qu’il est là !»
Lorsque son calendrier le lui permettait, il assistait volontiers aux créations, surtout lorsqu’il s’agissait de compositeurs qu’il connaissait bien, ou lorsque sa curiosité avait été éveillée par la presse ou par des amis. Ainsi, il s’était enthousiasmé pour Mass de Bernstein, qui avait été très mal accueilli lors de sa création. Il prit sa défense dans une interview donné à John Gruen pour le New York Times en 1971 : « Je pense que c’est le grand œuvre de Bernstein. Pour moi, tout sonne juste! Vous avez son âme et ses convictions, et tout son fantastique talent présenté sur un plat d’argent. Oui, c’est « populaire ». Non, ce n’est pas hétéroclite. C’est du pur Bernstein. Si vous l’aimez, vous aimerez l’œuvre. C’est ce que je fais. Dans mon univers, il y a de la place pour Stravinsky, Nono et Bernstein. Je suis fatigué de voir un des plus grands talents du siècle se faire éreinter et calomnier. Profitons plutôt de lui tant qu’il est là !»